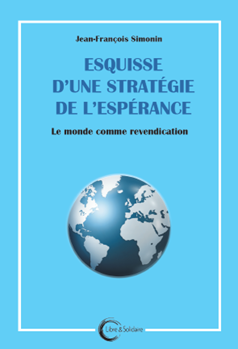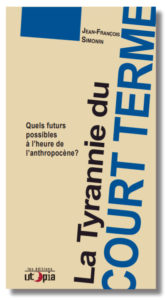Quatre bouleversements récents dans la perception du temps
Nous serions victimes d’une certaine « tyrannie du court-terme ». Nous serions entrés dans le temps de l’urgence. L’enjeu, dit-on, serait de retrouver une capacité apparemment égarée de nous projeter dans la longue durée. Mais la réalité est différente. Il vaut la peine de revenir sur cette question au moment où prendre le futur au sérieux pourrait bien devenir une des tâches politiques fondamentales pour les décennies à venir.
Depuis un siècle environ deux modifications lourdes s’étaient introduites dans la perception de la durée au sein des sociétés occidentales : la synchronisation de l’ensemble de l’expérience humaine au travers de l’instauration d’un temps universel, et la découverte de la très longue durée. Puis, plus récemment, depuis la fin du XXe siècle, deux autres phénomènes sont venus bouleverser encore nos rapports traditionnels avec la temporalité : la prise de conscience de l’anthropocène, qui bouleverse les échelles respectives des durées humaines et inhumaines, et les télécommunications numérisées qui diffusent sur la surface du globe une information instantanée modifiant de fond en comble notre expérience de la temporalité. Notons que ces bouleversements n’ont pas encore touché toutes les populations sur la Terre avec la même prégnance, ce qui complique la mesure de leur poids réel sur les représentations collectives à horizon BH22. Mais ces modifications de notre perception temporelle représentent les plaques tectoniques sur lesquelles reposent nos enjeux de civilisation les plus stratégiques.
Premier bouleversement, donc, datation et synchronisation du temps. D’une part nous sommes presque devenus capables de tout dater, d’autre part nous savons tout synchroniser, et ceci au niveau planétaire. Pour la première fois dans l’histoire, toutes les disciplines scientifiques savent dater leur objet : le paléontologue sait dater chacune des espèces existantes, voire disparues, le linguiste sait dater l’apparition des langues, l’astronome connaît la date de naissance de l’univers, des galaxies, le géophysicien sait dater l’âge de la Terre. Pour ce qui concerne la synchronisation nous sommes graduellement passés du cadran solaire à la clepsydre, puis au sablier, aux horloges à folio, au pendule, puis à la montre à quartz. Nous sommes tous à la même heure depuis un siècle environ (En France depuis 1891, et au niveau mondial depuis la loi de 1911 qui instaure un temps universel). Aujourd’hui, à bord de chaque satellite GPS, sont embarqués différentes horloges atomiques qui fournissent des références temporelles très précises, transmises au monde entier par les récepteurs GPS, dont l’horloge est synchronisée à celle des satellites. Quiconque est connecté au réseau mondial peut alors déterminer l’heure à cent milliardièmes de seconde près, sans avoir à se soucier de la fabrication, de l’achat, ni même du fonctionnement de ces horloges atomiques. Pour davantage de précision encore, on utilise l’UTC (méthode de calcul du Temps Universel Coordonné). Réseaux électriques, de télécommunications, de transports, marchés financiers sont ainsi synchronisés, et les experts estiment que nous ne sommes pas au bout des extraordinaires applications de cette révolution dans la mesure d’un temps universel. Mesure-t-on la profondeur des implications de cette révolution dans la vie de tous les jours ? En deux ou trois générations nous passons d’une époque au cours de laquelle un individu avait toutes les peines du monde à connaître son propre âge ou celui de ses parents, et de grandes difficultés pour synchroniser ce type d’information au niveau régional, national, et, en de très rares occasions, au niveau mondial – à une époque de mesure du temps en temps réel et synchronisé au niveau mondial. On dirait que « l’univers entier est entré dans le temps[1] ». On pourrait penser que notre perception du temps s’en trouve simplifiée, mais il n’en est rien : c’est plutôt l’idée de contingence qui en ressort renforcée. Comme le résume M. Serres,
il s’agit d’articuler un ensemble bariolé de paysages et de temporalités d’ordre différent. Comme par exemple l’histoire des galaxies et l’histoire des espèces. Ces histoires contiennent des bifurcations totalement contingentes qui émergent comme des coups de théâtre, certes, mais au voisinage de l’impossible, comme une sorte de miracle, comme des événements à très faibles probabilités et pourtant, en articulant tous ces événements, tous ces rythmes, toutes ces dimensions incommensurables, on parvient à un récit « sensé ». En tournant notre regard de l’avenir impossible à prédire vers le passé consommé, le contingent devient presque nécessaire… Il faut admettre une nouvelle signification au mot. C’est un récit qui a intégré la théorie du chaos, qui sait que l’avenir est imprévisible, qui sait que, quand on se retourne, il est pourtant déterminé, qui sait qu’il y a des choix aléatoires.[2]
Second bouleversement, découverte scientifique de la très longue durée. Nous venons de découvrir, essentiellement au travers de plusieurs découvertes fondamentales entre la fin du xixe et jusqu’au milieu du xxe siècle, l’immensité du temps. Qu’il s’agisse de géologie, de paléontologie, d’évolution des espèces, d’astrophysique, nous nous retrouvons « subitement » confrontés à des durées sans commune mesure avec les durées historiques qui constituaient nos principaux repères temporels traditionnels. Immensité du temps vers le passé, immensité vers l’avenir. Perspectives globalement vertigineuses, à la fois désespérantes ou enthousiasmantes. La dimension abyssale du futur qui ressort de ces découvertes n’est pas encore réellement assimilée par le sens commun, n’inspire pas encore réellement nos pensées, nos actions, et encore moins nos stratégies et politiques contemporaines. Mais nous oublions qu’il s’agit de découvertes relativement récentes. Lorsque nous invoquons la nécessité d’intégrer la longue durée dans nos raisonnements politiques, nous ne mesurons pas vraiment l’exceptionnel effort de retournement de la pensée que cette nécessité implique.
Voici quelques décennies on nous expliquait encore que Dieu avait créé le monde il y a six mille ans environ ; que cette création était principalement destinée à ménager à l’homme une expérience transitoire, qui prendrait fin collectivement lors du jugement dernier, et que l’essentiel de l’expérience humaine consistait à tendre vers un salut extra-terrestre. En regard de ces paramètres qui ont forgé et forgent encore en grande partie les structures de la conscience collective occidentale, les perspectives ouvertes par les sciences contemporaines sont proprement vertigineuses et perturbent naturellement nos capacités d’anticipation collective. Gilbert Hottois résume l’envergure du problème auquel nous avons à faire face.
… On nous parle de plus en plus, en ce tournant du millénaire, de hasards infiniment nombreux, de contingence radicale, de passé incommensurablement ancien – dix, quinze milliards d’années – et d’un futur vertigineusement ouvert sur une durée encore plus longue et évidemment inanticipable… Tels sont les récits cosmologiques et néo-darwiniens contemporains : l’apparition de l’espèce humaine y est décrite comme le produit non nécessaire d’un nombre extrêmement élevé d’événements aléatoires non programmés, un produit dont l’avenir est radicalement indécidé ; certaines cosmologies surenchérissent en supposant que l’apparition de l’univers lui-même et du temps est l’effet contingent d’une fluctuation du vide quantique éternel qui pourrait d’ailleurs, selon certains physiciens et mathématiciens, réengloutir l’univers, brusquement et sans préavis… Comment faire sens avec de pareilles histoires qui n’en ont pas, comment faire sens sans se replier sur la seule gestion et jouissance de l’instant et du local ou dans le giron des attitudes religieuses qui entérinent l’impuissance et l’insignifiance de l’humanité face à l’infini, fût-il le vide quantique éternel ou l’inconcevable antérieur au Big Bang ? [3]
Tout reste à construire en matière de longue durée en ce début de xxie siècle, ainsi qu’en matière d’anticipation. Là où l’anticipation a consisté pendant des siècles à se préparer pour l’Au-delà, sans avoir à aucun moment à prendre en charge la destinée des générations à venir, elle doit chercher à présent des moyens et des raisons de vivre non seulement aujourd’hui, pour nous-mêmes mais également demain, pour d’autres après nous.
Ensuite et très récemment, les conséquences de l’anthropocène en matière de perception du temps. Ce que l’anthropocène met à jour en ce qui concerne les échelles du temps, c’est l’hypothèse d’un renversement des perspectives temporelles telles qu’elles formaient traditionnellement la toile de fond de l’enchaînement des événements. On peut dire qu’il s’agit de la naissance d’un « nouveau temps du temps »[4]. Avec l’anthropocène la différence de magnitude entre l’échelle de l’histoire humaine et l’échelle biologique et géophysique diminue brusquement, au point de menacer de s’inverser : notre environnement pourrait à présent changer plus rapidement que notre culture. La Terre passe ainsi du statut de refuge solide et paisible à celui d’un décor fragile, mis à mal par les affaires humaines. Du coup elle en devient menaçante, éventuellement imprévisible, capricieuse, incompréhensible. Cette nouvelle perception est très récente. Elle date du tout début du xxie siècle. Car c’est une chose de savoir, comme nous le savons depuis un siècle environ, que la terre va disparaître dans quelques milliards d’années, et que l’espèce humaine va donc s’éteindre à une échéance indéterminée ; c’en est une autre de comprendre comment les scientifiques expliquent à présent que les générations proches, très proches, celle de nos enfants, nos petits-enfants, auront à vivre dans un milieu appauvri. L’anthropocène invite à concevoir le temps qui passe comme une opération de rétrécissement de la durée et des possibles qu’il recèle pour les générations à venir. Cette nouvelle perception n’est pas encore réellement comprise dans les sociétés occidentales, elle n’a pas encore imprégné nos modes de penser, et encore moins nos programmes politiques.
Enfin, la communication instantanée telle qu’elle se construit sous nos yeux grâce à de prodigieuses innovations technologiques dessine un espace-temps d’un genre nouveau. Technologies de l’information, réseaux sociaux, réticulation planétaire, terminaux mobiles toujours plus puissants et légers, tout cela contribue à consolider une connectivité mondiale en cours de généralisation. Nous utilisons aujourd’hui des applications inimaginables voici dix ans seulement. Dans dix ans, data mining et géolocalisation, entre autres innovations, auront certainement fait voler en éclat les frontières aujourd’hui établies entre sphère privée et sphère publique. Et bien d’autres fondamentaux actuels de la définition ontologique de l’homme seront touchés également : la notion de proximité tend à se centrer autour des amis rencontrés sur les réseaux sociaux ou des favoris sur les réseaux professionnels ; une décision prise à un endroit quelconque de la planète peut avoir des implications quasi instantanées très loin de sa source. Enfin ces moyens techniques contribuent à une sorte de compression du temps qui se manifestera selon deux axes sur lesquels nous reviendrons en détail ultérieurement : le flux des informations qui émane de ces moyens techniques nouveaux produit une sensation d’accélération de l’histoire, ou confère à ces sensations un caractère plus éphémère. Dans tous les cas la perception intime du temps vécu s’en trouve bouleversée.
Au total on comprend mieux pourquoi les sociétés occidentales peinent à mettre au point des stratégies cohérentes vis-à-vis des enjeux relativement récents auxquelles elles ont à faire face. Ces sociétés ont vécu depuis un siècle, et continuent à vivre actuellement, de véritables bouleversements dans leur perception du temps. Il serait quasi miraculeux qu’elles parviennent spontanément à s’accorder sur des échéanciers ou des agendas politiques sur longue durée, par exemple à horizon BH22. En fait le concept de temps long, ou de longue durée, est un concept qui reste en cours de définition. Et tant que ce concept ne sera pas mieux stabilisé, il y a fort à parier que les choix stratégiques, fussent-ils porteurs de dangers bien réels, resteront déterminés en fonction de critères de court terme.
[1] Michel Serres, d’Hermès à Petite Poucette, qui cite S. Hawkings, p. 300.
[2] Michel Serres, d’Hermès à Petite Poucette, p 312.
[3] Gilbert Hottois, Dignité et diversité des hommes, p. 152.
[4] Collectif, De l’univers clos au monde infini, p. 291.
Jean-François Simonin, décembre 2018