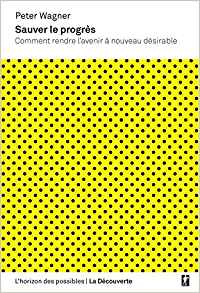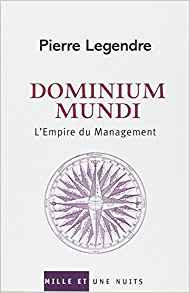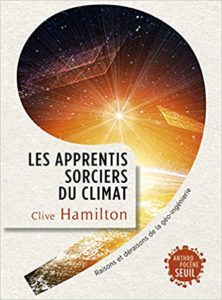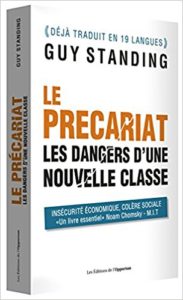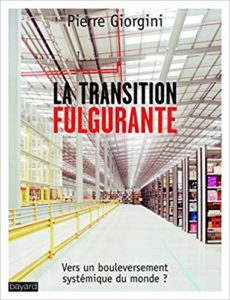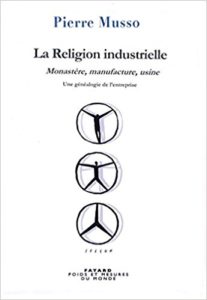La siliconisation du monde. L’irrésistible expansion du libéralisme numérique, L’échappée, 2016.
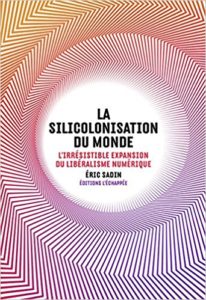
Eric Sadin veut ici nous alerter quant à l’émergence d’un nouveau modèle civilisationnel, fondé sur l’organisation algorithmique de la société et risquant de dessaisir l’homme des tenants et aboutissants de sa propre existence et de son propre avenir individuel et collectif. Certes, la Silicon Valley est le lieu d’implantation physique de nombre des acteurs du numérique. C’est de là qu’après-guerre la conjonction du développement de l’appareil militaire américain et de la promotion du monde post-industriel, composé en grande partie d’ « information », a enfanté de l’ère du numérique qui nous submerge aujourd’hui.
Mais à présent, explique Sadin, la Silicon Valley ne renvoie plus prioritairement à un territoire. C’est avant tout un esprit qui, déclarant œuvrer pour le bien de l’humanité, est en passe de coloniser le monde. Une colonisation, certes, d’un genre nouveau, avec de nouveaux missionnaires, de nouveaux mythes, de nouvelles valeurs. Avec eux nous entrons, dit Sadin, dans « l’accompagnement algorithmique de la vie, destiné à offrir à chaque être ou entité, à tout instant, le meilleur des mondes. » (p. 20)
Vision du mode et horizon industriel
Nous entrons, à l’orée de la troisième décennie du XXIe siècle, dans un nouvel horizon industriel. « Désormais, le monde génère une copie sans cesse plus fidèle de lui-même. Ses états se trouvent dupliqués et détaillés en code binaire, témoignant en temps réel de situations toujours plus nombreuses et variées. Les phénomènes du réel sont saisis à la source et aussitôt mesurés, ouvrant un horizon virtuellement infini de fonctionnalités. L’extension des capteurs sur nos surfaces corporelles, domestiques et professionnelles, croisée à la puissance de l’intelligence artificielle, constitue l’horizon industriel majeur de notre époque. Il n’y a pas de limite à la mise en données du monde et aux usages qui pourront être conçus. » (p. 20)
Nous entrons dans un nouveau TINA (There Is No Alternative). Non plus le TINA des années 1980 de Margaret Thatcher ou Ronald Reagan, qui visait à promouvoir les dérèglementations et les logiques concurrentielles en tout lieu et en toute circonstance. Un TINA numérique, en quelque sorte. « Un nouveau TINA, non plus considéré comme un mal nécessaire, mais porté par une fascination considérant cette trajectoire comme étant non seulement vertueuse, mais naturellement inscrite dans le cours de l’histoire et figurant l’horizon indépassable de notre temps. L’esprit de la Silicon Valley engendre une colonisation – une silicilonisation. » (p. 24) Et au-delà du modèle industriel, c’est un nouveau modèle civilisationnel qui s’instaure. Nous entrons, dit encore Sadin, dans « l’ère de la mesure de la vie. » La nature du numérique évolue, et vite. Jusque-là cantonnée à l’assistance pour la gestion des données, elle se dote actuellement d’une aptitude interprétative et décisionnelle. L’extrême sophistication de l’intelligence artificielle fait passer le numérique de la capacité plus ou moins fine à observer et archiver les informations, à la capacité de suggérer des solutions, proposer des évaluations et à engager des actions concrètes. La vocation du numérique franchit actuellement un seuil, procurant un pouvoir sans précédent à ceux qui l’organisent et le dirigent.
Il ne faut pas parler du numérique comme d’un domaine qui serait isolé de ses propres fondements et de ses applications. Avec le numérique nous sommes en plein régime des technosciences, ces sciences qui n’ont plus de raison d’être sans les applications qui leur sont liées. Mais il ne faut pas substantialiser le numérique. « Le numérique, ça n’existe pas, entendu comme une « être » situé à distance de ses conditions de formation, conformément à une sorte d’essentialisme envoûté. La vérité, c’est qu’il existe des procédés et des systèmes dont la nature et les fonctionnalités sont aujourd’hui moins conditionnées par des recherches scientifiques que par les ambitions industrielles. Il se produit un niveau de raccordement inédit entre le technique et l’économique, prenant la forme d’une emprise quasi absolue de l’économique sur le technique. Mutation qui renverse l’ordre autrefois existant. » (p. p. 33)
Par exemple un compteur électrique dit « intelligent » suggérera des rythmes et des modalités d’utilisation orientés, de façon à assurer l’optimisation de la gestion des stocks d’énergie disponible – ou optimisation au sens de la valorisation envisageable, indépendamment de la question des stocks disponibles – l’histoire ne nous dit pas encore aujourd’hui de quel type d’optimisation il s’agira. Ce qui est visé, en tout cas, c’est un encadrement de certaines actions, établi selon des règles sensées être explicites pour toutes les parties, mais en pratique inaccessibles ou incompréhensibles pour la plupart des citoyens ordinaires. Les bracelets connectés mesurent nos gestes et flux physiologiques, peut-être pour s’occuper de notre bien-être, mais plus sûrement pour nous proposer des produits et services liés à nos déficiences performatives. Et la tendance des industriels sera ensuite de « remonter dans la chaine de valeur ». « On comprend l’intérêt pour Alphabet-Google de passer à l’étape ultérieure, non plus celle consistant à offrir la « meilleure » et la plus rapide réponse à toute requête formulée, mais celle ambitionnant de littéralement piloter le cours de la vie… Il indique, à coup sûr, la tendance forte à se développer à l’avenir. » (p. 114) Le numérique, c’est une façon pour le capitalisme de se lancer à l’assaut de nouveaux domaines d’extension de son régime de vérité. Il s’agit à présent de « se lancer à l’assaut de la vie, de toute la vie ». (p. 126)
« C’est une vision du monde qui est à l’œuvre, fondée sur le postulat techno-idéologique de la déficience humaine fondamentale, que les pouvoirs sans cesse variés et étendus affectés à l’intelligence artificielle représente la plus grande puissance politique de l’histoire, appelée à personnifier une forme de surmoi à tout instant doué de l’intuition de vérité et orientant le cours de nos actions individuelles et collectives pour le meilleur des mondes. » (p. 30)
Exploitation de la vie
La silicolonisation, c’est ce débordement du numérique sur de nombreux aspects de la vie quotidienne. On assiste à l’éruption d’internet hors des écrans et des interfaces tactiles pour s’infiltrer dans des domaines sans cesse plus divers de nos réalités. « C’est un double débordement qui actuellement s’opère, prenant la forme d’une double conquête : celle du monde et de la vie. D’un côté l’infrastructure industrielle, institutionnelle et financière de la Silicon Valley tend à être reproduite plus ou moins à l’identique dans de nombreuses régions de la planète. De l’autre, le modèle qu’elle a engendré vise à exploiter chaque impulsion de la vie. » (p. 74) Il s’agit pour les chercheurs et les industriels de matérialiser les idéaux des technoprophètes de la Silicon Valley, ceux qui veulent « faire du monde un endroit meilleur », comme ils le répètent lors de chaque brainstorming. Déjà Steve Jobs, dans les années 1980, estimait que « le Mac sauverait le monde ». Aujourd’hui, toute la strate des hauts dirigeants de Google proclame avoir « la conviction qu’il est possible de rendre le monde meilleur grâce à la technologie. »
Dans ce contexte, les flux numériques se confondront avec les flux de la vie. On visera l’augmentation de la vie par le truchement de la technologie. La Singularity University, fondée par Ray Kurzweil et Peter Diamandis en 2008, promeut activement cette idée. Elle essaime et ouvre des antennes sur les cinq continents. Silicolonisation en action, elle est à la fois un Think tank et un incubateur d’entreprises. Elle est massivement soutenue par Alphabet-Google. Son objectif assumé « est d’éduquer, sensibiliser et impliquer les hauts dirigeants, à l’échelle mondiale, dans l’utilisation des technologies exponentielles pour faire face aux défis de l’humanité. » Sadin cite l’exemple de la NSA et de son « processus psychiatro-sécuritaire », qui a construit dans l’Utah un immense centre de serveurs supposé répondre pour les décennies à venir « aux besoins en stockage de données et travaille à la création d’un ordinateur quantique, visant in fine à cartographier en temps réel la quasi-intégralité de la vie de la planète. » A ce moment, la vie humaine ne consistera plus à agir en fonction d’une capacité de jugement et d’action, mais à seulement rétroagir à des signaux. C’est un soft totalitarisme numérique qui s’impose insidieusement, dessaisissant l’homme de son droit à agir en conscience et selon son libre arbitre.
Il s’agit en d’autres termes d’un technolibéralisme libre d’agir sans entraves et selon les règles qu’il s’est lui-même fixé. Il pourrait nous conduire à l’éradication de la figure humaine. « Soit la mort de l’homme, celui du XXIe siècle, certes envisagé comme un être agissant, mais qui, pour son bien et celui de l’humanité entière, doit désormais se dessaisir de ses prérogatives historiques pour les déléguer à des systèmes autrement plus aptes à parfaitement ordonner le monde et à lui assurer une vie débarrassée de ses imperfections. » (p. 103) Nous assistons, comme impuissants et peut-être fascinés, à une sorte de passation de pouvoir de la raison humaine à des systèmes, pourtant sortis de cerveaux humains, sensés éclairer de leurs nouvelles lumières des pans sans cesse plus étendus de nos existences.
Dangers en vue au bout du numérique ?
Il pourrait donc exister quelque chose de nihiliste dans l’avènement du numérique, un nihilisme qui pourrait virer à l’antihumanisme radical. Sont directement attaqués les principes fondateurs de l’humanisme occidental, reposant sur la liberté individuelle et la progression régulière vers l’autonomie de jugement. Le principe de responsabilité pourrait bien en être affecté, lui aussi, et mener à un processus de décivilisation. L’ontologie sous-jacente au numérique consiste à disqualifier l’action humaine au profit d’une raison algorithmique jugée supérieure, ou en tout cas plus opérationnelle au sens de la détection des besoins humains et de la capacité à imaginer rapidement des produits et services susceptibles de les satisfaire.
Dans ce contexte Sadin se considère désormais, dit-il, comme un lanceur d’alerte. Non pas pour démasquer des faits répréhensibles qui seraient masqués et qui appelleraient à être dénoncés en raison de leur gravité ; « mais en m’efforçant d’identifier les signes épars et convergents qui témoignent d’un recul insensible de certains acquis démocratiques autant que d’offenses infligées à la dignité humaine. » (p. 37) Selon lui il serait coupable de ne pas décrire la désolation en cours et de ne pas œuvrer à la fabrication d’instruments de compréhension et d’action, portant des germes d’espérance.
Nous vivons un moment singulier de l’histoire de l’humanité caractérisé par une extrême puissance technologique, puissance dépourvue de tout cadrage politique et anthropologique. Sadin alerte : nous avons quitté le vieux monde, celui de la vérité, du discours, de la rationalité au sens classique, sans nous en apercevoir. « On continue d’envisager la technique comme le résultat de recherches menées au sein de laboratoires, conduisant éventuellement au développement d’applications, opérant dans un second temps toute une série d’effets sur les modes d’existence. Mais il s’agit là d’un schéma réducteur. Ce qu’il faut saisir, c’est que les technologies de notre temps, celles des données et de l’intelligence artificielle, ne produisent pas des effets, mais se situent au point nodal de la crise de la démocratie : celui du dessaisissement de la décision humaine. Ce sont les fondements de notre civilisation, l’autonomie du jugement et la liberté d’action, qu’elles sapent soudainement. » (p. 228)
La question est de savoir si nous devons accepter cette dépossession, ou si nous envisageons individuellement et collectivement de retrouver la capacité, pour l’instant égarée, de reprendre la main sur ce cours des choses qui nous marginalise progressivement. Si nous ne prêtons pas davantage d’attention à cette question, il se pourrait que l’humanité y perde une part fondamentale de son histoire et de son avenir. Sadin préconise l’élaboration d’une cartographie des responsabilités à ce sujet. La question est plus politique que scientifique. Il y a belle lurette que l’homme de science n’a plus les moyens de faire preuve de conscience critique, il dépend trop du monde des affaires qui le finance, l’outille et lui dicte ses thèmes de recherche. Il a pris l’habitude de mener ses recherches dans l’indifférence de leurs conséquences. Il y a « irresponsabilité institutionnalisée et banalisée. On affirme, en boucle et de concert, œuvrer au bien de l’humanité, on touche de considérables émoluments, et on se lave les mains de tout le reste. » (p. 248) Sadin rappelle ironiquement le mot de Jules Verne à ce propos, façon de rappeler que la question n’est pas neuve : « Les ingénieurs modernes ne respectent plus rien ! si on les laissait faire, ils combleraient les mers avec les montagnes, et notre globe ne serait qu’une boule lisse et polie comme un œuf d’autruche, convenablement disposée pour l’établissement des chemins de fer. » En fait, l’homme de science ne peut plus prétendre qu’il vise à améliorer la condition humaine, pour la simple la raison qu’il œuvre sous le couvert d’une rationalité économique hors de son contrôle.
Jean-François Simonin, Juin 2017