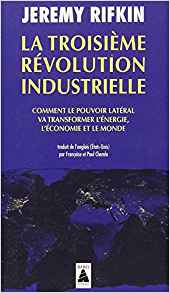Qui êtes-vous, Jean-François Simonin ?
Ci-dessous le texte que je transfère aux organismes ou personnes qui demandent un descriptif sommaire de mes travaux dans le cadre de BH22.
Quelle est la vocation du site « BH22 » ?
BH22 est un site multifonction : il sert de plateforme d’échanges d’articles pour les membres d’une association, de moyen de partage de recensions d’ouvrages dans le cadre d’un club de lectures croisées, de recueil de « paroles extraordinaires sur le futur » et, enfin, il sert de moyen de présentation de mes publications. Au fil du temps BH22 est devenu le lieu unique où je centralise l’ensemble de mes réflexions et travaux relatifs aux principaux enjeux contemporains de civilisation. Certains de ces travaux remontent aux années 1990, mais la plupart sont plus récents.
Qui êtes-vous, précisément ?
Je suis un homme d’entreprise. J’ai 30 ans d’expérience professionnelle dans différentes fonctions, dans différents secteurs d’activité mais le plus souvent dans le secteur de l’industrie au sens large : Agriculture, Agro-alimentaire, Presse, Chimie ; et j’interviens actuellement en tant que consultant dans les domaines de la production des métaux et de leur première transformation, la Forge, la Fonderie, la Construction Mécanique, Aéronautique, Ferroviaire, le Spatial, la Défense, les SSII. Mon CV actualisé est en ligne sur LinkedIn.
Je suis quotidiennement confronté à des questions de choix stratégique, à des projets de cessions-acquisitions, de R&D, d’investissement, de numérisation, d’automatisation, de délocalisation, d’externalisation, de financiarisation, de formation, de restructuration, de plans sociaux… Je connais le rationnel des marchés financiers, des conseils d’administration, des comités exécutifs, de la gestion de projet ; la puissance des normes comptables et des agences de rating, la logique des benchmarks et des cash flows actualisés, les outils et les pratiques des cabinets conseil ; ainsi que les enjeux du dialogue social et les difficultés des représentants des salariés à faire valoir le point de vue de la pérennité économique, de l’emploi et des conditions de travail. J’ai l’opportunité d’observer de près comment se dessinent les orientations stratégiques des principaux acteurs de l’économie mondiale, et je suis interpellé par les implications à long terme que préparent ces stratégies. Depuis la crise de 2008, j’ai perdu confiance dans la capacité de la rationalité occidentale à sécuriser l’avenir d’une civilisation devenue planétaire, mais restant dépourvue de pensées, d’outils et de pratiques pertinents à cette échelle. L’économie mondiale va, à grande vitesse et en accélérant, vers d’évidentes impasses technoscientifiques, énergétiques, climatiques, génétiques, et surtout humaines. Personne n’est en charge de ces implications, qui ne sont donc de la responsabilité juridique d’aucune entreprise, d’aucun gouvernement, d’aucune instance internationale. BH22 vise à rassembler quelques réflexions à la croisée de ces problématiques.
Vous inspirez-vous de quelques travaux ou auteurs en particulier ?
J’ai suivi différents cursus de formation à la gestion et au management, mais je suis de formation philosophique au départ. Je pense être plus particulièrement redevable à Descartes et Nietzsche. Ces deux auteurs m’ont certainement un peu plus marqué que les autres. Descartes pour son obsession de la clarté et de la rigueur, Nietzsche pour son obsession du sens et de la projection.
Et, concernant les problématiques centrales de BH22, j’ai été au départ largement inspiré par Paul Valéry, Gaston Berger, Hans Jonas, Günther Anders et Daniel Innerarity, c’est-à-dire les quelques auteurs – trop rares à mon avis – qui ont fait de la réflexion sur l’avenir le centre de leurs investigations. Je suis également de près tous les travaux de prospective, d’où qu’ils viennent, et en particulier les travaux de la futurologie américaine. Mais je dois mentionner une attirance de plus en plus forte pour les réflexions de type historique ou philosophique. J’ai le sentiment que là résident nos plus solides atouts pour sortir de la crise contemporaine de l’avenir. Car les issues des impasses actuelles de civilisation seront d’ordre philosophique, politique et culturel, plus sûrement que d’ordre technologique, industriel ou financier. L’idée de progrès qui nous a servi de guide depuis les Lumières jusqu’à la fin du XXe siècle est obsolète, elle devient à présent contre-productive, suicidaire – nous devons en élaborer une nouvelle. L’humanité doit inventer une façon neuve de poursuivre son chemin vers l’émancipation. Il y a dans cette affaire à la fois un côté tragique et un côté exaltant. BH22 essaie d’apporter un maximum de clarté sur cette question, de multiplier les angles de vue. Il s’agit, dans mon esprit, de se préparer à de profonds bouleversements, voire de produire des idées de transformation qui rendraient concevables la poursuite d’une certaine forme de progrès tout en évitant les impasses dans lesquelles la civilisation pourrait aussi bien sombrer.
La vie des entreprises en sera bientôt profondément modifiée. Leur vocation, leur utilité et leur rôle dans le tout de la vie sociale sera redéfini ; leur centralité sera mieux reconnue, mais leurs responsabilités en seront augmentées. Les avantages compétitifs de demain n’auront plus rien à voir avec ceux d’aujourd’hui. Une nouvelle déontologie encadrera la stratégie des plus grands acteurs de l’économie mondiale. L’entrée dans l’anthropocène n’offre pas d’autre option : elle impose un nouveau cadrage cosmologique des plus grandes entreprises humaines, publiques et privées, dans le monde entier.
Justement, qu’est-ce que l’anthropocène, dont vous faites régulièrement un sujet central dans vos écrits et vos exposés ?
L’anthropocène est le concept au travers duquel nous prenons conscience que les politiques et stratégies déployées par les principaux acteurs de la mondialisation conduisent à l’effondrement de la civilisation occidentale et, partant, de l’ensemble de la planète. L’entrée dans l’ère de l’anthropocène signifie que nous avons franchi le seuil à partir duquel l’avenir de la biosphère ne dépend plus que de nous, espèce humaine, devenue surpuissante, mais malheureusement incapable de contrôler cette surpuissance. L’humanité, sa démographie, son industrie et ses technologies en expansion sont devenues les facteurs les plus déterminants des équilibres du vivant. A partir de l’anthropocène, il n’existe plus de nature naturelle. Il n’existe plus qu’une seule nature, humaine.
L’anthropocène est le marqueur à partir duquel il devient officiellement coupable de prolonger les logiques technoscientifiques et économiques en vigueur dans l’économie mondialisée du XXIe siècle. Toute la série Clés d’accès au XXIIe siècle, dont je présente plusieurs extraits sur le site BH22, représente un effort pour envisager une nouvelle infrastructure de civilisation, apte à supporter une projection sur le long terme – en l’occurrence à l’horizon du siècle prochain.
Jean-François Simonin, septembre 2017