Pour tout contact relatif à BH22
Jean François Simonin | Institut du temps long
BH22 – Réflexions philosophiques et prospectives sur les enjeux de long terme

Mille et une nuits, 2007.
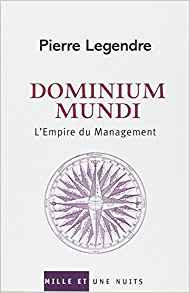
Dominium Mundi est le scénario d’un film qui pose la question : « à qui appartient le monde ? », et s’inquiète « du côté aveugle des revendications de légitimité pour s’approprier le monde ». Il cherche à identifier ce qui, à long terme, pourrait résister à la dissolution du monde dans les routines de la mondialisation. « Le scénario repose sur la conscience que la Globalisation de la techno-science-économie, rendue possible par la pertinence fonctionnelle du Management, ne se confond pas avec une occidentalisation-américanisation du monde censée signifier le point d’aboutissement des civilisations. La capacité stratégique n’est pas l’apanage de l’Occident, et le futur n’est pas planifiable. L’intrigue de ce documentaire se résume à ceci : donner à voir la verve industrielle, quelques prodiges éloquents accomplis aux quatre coins de la Terre ; mais, aussi, recueillir les preuves de ce qui résiste ou annonce la résistance à la menace d’extermination des identités. » (p. 10-11)
Pierre Legendre pose dans ce petit livre tonique et subversif un nombre considérable de questions qui doivent nécessairement être posées dans le cadre d’une réflexion sur l’industrialisation et ses implications à long terme. Il aligne les formules choc qui sont autant de constats ou avertissements donnant à réfléchir dans le cadre de la mondialisation et des modes de « management » qui la gouvernent. Le questionnement est à la fois profond et planétaire.
« Le système occidental promu par l’Occident rivalise avec le grand rêve religieux. Il exalte les grandes surfaces paradisiaques, les cérémonies à la mode, la beauté des images à consommer. La publicité s’est appropriée la spiritualité de la toilette (Beaudelaire), l‘architecture des mannequins, les corps possédés par la musique, par le maquillage et les parfums. » (p. 23) « Avec la Modernité, le Dieu s’éloigne et s’efface. Alors, l’homme devient le Souverain. Aujourd’hui, la nouvelle Bible, laïque mais toujours conquérante, s’appelle Technique-Science-Economie. » (p. 25) Elle met fin aux savoirs antiques, elle abolit les mythes, elle promeut la gestion, elle glorifie le self made man. « Comme Dieu, la science globalisée capte la force religieuse, avant tout celle de l’Occident, la force stratégique du christianisme occidental. Tendue vers un Âge d’or, elle prépare la suppression de la souffrance, la santé parfaite, la vie illimitée. Moyennant finances. Et moyennant la Foi au pouvoir infaillible : comme Dieu souverain, la science ne peut ni se tromper, ni nous tromper. » (p. 29) Forts de cette nouvelle foi, les entreprises privées et leurs manageurs affrontent le temps, la finitude, le néant. Elles conçoivent, extraient, fabriquent, industrialisent et rejettent des morceaux de monde, elles reconfigurent la scène de l’univers. « Le Dieu du poème biblique, juif ou chrétien, est battu. Aujourd’hui les Occidentaux prophétisent au nom de la science. Ils annoncent la fin du déchirement humain. La grande promesse occidentale des lendemains d’immortalité est devenue à son tour objet de marché. » (p. 30) Et gare aux récalcitrants. Le Japon voulait-il résister, vers le milieu du XXe siècle, aux assauts de la colonisation et du christianisme ? « Il a reçu les Lumières occidentales sous le coup imparable de l’éclair atomique. »
Legendre veut donner à voir, pour en apprécier les pouvoirs, le concept occidental de « religion ». Il voit dans la Religion Industrielle occidentale « une forme de décomposition du Monothéisme issu de la culture européenne… sur fond d’effacement de la frontière entre la sphère de la représentation et la réalité, donc une civilisation du passage à l’acte – qui récupèrent la tradition théologique politique, matrice des montages de l’État et du Droit, en l’ouvrant au marché. Dès lors il devient peu à peu concevable de faire entrer la notion de souveraineté, si dépendante d’un mode de raisonnement qui porte en Europe la marque de l’absolutisme divin, dans la catégorie des biens commerciaux. » (p. 76-77)
Mais le management est plastique : « Il comporte autant de centres qu’il existe de pouvoirs en concurrence dans la civilisation où tout se s’achète et se vend. Des myriades de pouvoirs en réseaux volatilisent les formes inaptes à la compétition. « Mais cette expérience inédite d’appropriation du monde reste soumise à son histoire, à la loi politique et aux énigmes du destin. » (p. 17) « L’Empire du Management a pour champ de bataille le marché planétaire. Les entreprises s’affrontent et luttent pour la victoire. » (p. 19) « Les multinationales sont des Empires privés, les républiques-mastodontes sans territoire de la nouvelle jungle féodale, où s’affrontent des décideurs qui sont les conquistadors d’aujourd’hui. » (p. 25-26) « Avec la nouvelle féodalité, les experts combinent les techniques de la planification, les recettes de la propagande des tyrannies du XXe siècle et les idées libertaires branchées. » (p. 48)
Nous sommes entrés dans l’ère post-westphalienne. Le véritable partage du monde ne s’opère plus entre nations, mais entre acteurs du marché. « Une multitude de conglomérats transcontinentaux, économiques et financiers, forment un seul et même théâtre mondial de la concurrence, où des États et des groupes d’États dominants tentent de jouer les chefs d’orchestre. » (p. 47) Le premier traité de management date de 1493 – donc au lendemain de la découverte de l’Amérique. L’édit du pape énoncé au nom de l’Empire universel du Christ représente, selon Legendre, la première pensée véritablement globale au sens où le manageur d’aujourd’hui est censé l’entendre. Il faut avoir ce fond à l’esprit si l’on veut comprendre « le rôle du droit dans le fonctionnement du Management mondialisé, c’est-à-dire le rôle de colle juridique pour faire tenir la techno-science-économie » au début du XXIe siècle. « Le Management a pris possession de la planète. Le christianisme occidental avait anticipé l’organisation ultramoderne en posant le principe ‘l’Eglise n’a pas de territoire’. Aujourd’hui, la Démocratie unie au management sans frontières lui fait écho. Le marché universel réalise le rêve des conquistadors de l’Amérique : ‘un Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais’. La Bourse en continu accomplit ce miracle.» (p. 21) « Les manageurs savent-ils qu’ils sont des guerriers, et qu’en manipulant les images et la parole ils manient de l’explosif ? On ne transplante pas les rêves comme des organes, d’un corps à l’autre. Dans la compétition universelle, les cultures douées de capacité stratégique sont des conservatoires d’identité. Agiront-elles pour s’auto-supprimer ? » (p. 23) « L’industrialisme surpuissant et le système financier sans frontière entraînent l’espèce humaine vers l’avenir inconnu. L’Efficacité est l’emblème des relations de jungle dans une reféodalisation planétaire. » (p. 17)
Le management d’aujourd’hui est l’équivalent des armées et des administrations d’hier. Il assure les mêmes tâches : organiser, coordonner, commander, contrôler. « Le Management mobilise les individus, les entraîne pour l’action. Son horizon d’humanité, c’est sa souplesse sociale et politique, sa capacité d’adaptation, à l’âge des robots et de la gestion électronique. » (p. 43) Il suscite des courants légèrement et temporairement alternatifs, mais n’a pas d’opposants véritables sur la durée. Il ingurgite tout ce qui est à sa portée, il avale le pour et le contre. « Et si le rêve américain d’un grand rêve universel allait lui aussi tourner au cauchemar ? » Nous vivons une culture qui semble vouloir en finir avec l’humanité. « La nouvelle absurdité promeut l’Homme total, nomade affranchi des liens, l’individu auto-fabriqué et auto-suffisant. » (p. 20) Le rêve du post-humain équivaut à un délire d’autodestruction d’un Occident qui se mire en lui-même, admirant tout ce qui le conduit à fragiliser l’avenir du monde et de l’espèce humaine. Globaliser, mondialiser, penser monde, rationaliser, tout cela signifie en fait occidentaliser, par le moyen du commerce. « Le temps et l’espace ont été plombés : l’histoire du monde sera engloutie dans celle de l’Occident, les civilisations seront absorbées par l’ordre occidental. La technique, la science et l’économie vont-elles accomplir cette croyance ? » (p. 22)
Alors, au final, à qui appartient le monde ? Il « appartient à ceux qui savent – qui savent que la conquête de la Terre par la Technique et l’économie n’est qu’un moment de la conquête de l’univers tout entier. La Mondialisation est une guerre pour la Vérité, qui doit être gagnée par ceux qui savent, qu’on appelle aujourd’hui les vainqueurs cognitifs ». (p. 39) « Pourquoi, mais pourquoi la planète n’est-elle pas docile au Nouvel Âge de la conversion universelle ? » (p. 25) « L’économie est devenue la nouvelle raison de vivre. Mais quelque chose se durcit dans les relations mondiales, quelque chose de guerrier, qui touche aux ressources généalogiques, à la Terre intérieure de l’homme. » (p. 60)
Publication : Jean-François Simonin, juillet 2016.
Nous vivions et pensions jusque très récemment, et ceci depuis les Lumières et l’établissement des Droits de l’Homme, dans l’idée qu’il suffisait de déployer une raison universelle sur la surface du globe pour obtenir richesse, bien-être, et perspective d’accumulation illimitée de toutes sortes de bénéfices matériels, dans le prolongement du projet cartésien de rendre l’homme « comme maître et possesseur de la nature ». L’intérêt de ce projet stratégique s’est trouvé largement confirmé par l’accroissement extraordinaire, sur les deux derniers siècles, du niveau de vie moyen dans les sociétés d’économie libérale. C’est ainsi qu’il a pu servir de matrice à la fois pour les projections individuelles et pour les projections collectives. Et c’est encore lui qui sert toile de fond aux méthodes d’analyse stratégique actuellement en vigueur dans les entreprises. Mais le prolongement de cette stratégie pose actuellement problème : outre la question des limites à cette stratégie de développement, étudiée au premier chapitre de cet essai, se pose le problème de l’éclatement des savoirs. Ce que l’on appelait la science se trouve actuellement dispersé dans une multitude de disciplines qui fonctionnent en silos, obéissant à des logiques d’expérimentation, de marché et de financement séparés les unes des autres, et nous nous découvrons totalement orphelins de tout moyen de coordination de ces différents pans d’évolution de nos sociétés. C’est tout notre concept de rationalité universelle, celui qui a servi de base à toutes les évaluations et à tous les arbitrages scientifiques, économiques, politiques et culturels sur les deux derniers siècles, qui semble actuellement « bifurquer » dans plusieurs directions simultanément.
En plus de la nouvelle profondeur qu’apporte chaque discipline à notre niveau global de connaissance, il faut composer avec l’éclatement des savoirs contemporains. Or, cet éclatement provoque une désorientation de la pensée. En se fragmentant à l’extrême l’espace de la connaissance contemporain n’offre plus les mêmes points de repère. La connaissance est actuellement éparpillée en divers lieux plus ou moins officiels, sûrs, connus ou confidentiels. Disciplines, sous-disciplines, secteurs, domaines, sujets : tout figure sur le même plan, tout semble équivalent. Dès lors, comment distinguer l’essentiel de l’accessoire ? On progresse vers l’infiniment grand, vers l’infiniment petit, on progresse en extension et en profondeur du savoir. Ce qui accroit encore la difficulté à nous positionner précisément entre ces perspectives qui tendent vers l’infini : anticiper pourquoi, comment, dans quelle direction ? Se replier sur notre présent ? Incontestablement la question se complexifie. Comment se repérer dans cette formidable complexité de notre environnement global ? Serait-t-on capable d’identifier certains enjeux prioritaires ? Devra-t-on constater avec Lewis Mumford que ce savoir restera « sans usage pour la vie » ?
Et à mesure que croissent leur taille et leur éloignement, la possibilité d’unir et d’ordonner rationnellement les éléments séparés s’évanouit. Aujourd’hui, l’accroissement quantitatif des connaissances, même dans les secteurs les plus limités d’une science, d’une technique, excède la capacité de communication effective, d’appréciation rationnelle ou d’assimilation des personnes. Si ce n’est quand il peut être exploité pratiquement dans des buts militaires, médicaux ou industriels, une proportion de plus en plus vaste de ce magnifique fonds de connaissance reste lettre morte, sans usage pour la vie.[1]
En raison de l’organisation en silo des disciplines scientifiques, la synthèse des visions de toutes ces disciplines dans l’analyse de l’état de la planète est quasi inexistante. « La science essaie d’être globale et d’aller au-delà d’une collection de disciplines distinctes, mais ceux-là mêmes qui empruntent une démarche scientifique systémique seraient les premiers à admettre que notre compréhension du système terrestre n’est guère meilleure que celle qu’un médecin du xixe avait de son patient. »[2] Même au niveau des seules sciences de la nature, avant même d’envisager l’impact des activités industrielles ou politiques, il n’existe pas de diagnostic partagé, et l’objectif d’un tel diagnostic semble largement hors de portée dans les cadres de réflexion aujourd’hui en vigueur dans les démocraties libérales. Quand on mesure le temps et les moyens nécessaires pour envisager un diagnostic planétaire sur le seul sujet de l’évolution climatique, quand on analyse les innombrables résistances à toute proposition de tenter une stratégie mondiale sur cette question, on mesure à quel point un diagnostic et une politique globale de traitement de la question des risques de rétrécissement du futur de la civilisation semblent totalement hors de notre portée. Oui, nous avons de sérieux risques d’aller vers des impasses stratégiques majeures sans capacité de réaction. Oui, l’éclatement des savoirs en ce début du xxie siècle participe de cette paralysie. En termes triviaux nous entendons parfois dire que « nous fonçons vers un mur avec le pied sur l’accélérateur », mais il faut bien voir que cette image retrace assez fidèlement la réalité. Ici encore la difficulté du problème se traduit par l’abandon de tout volontarisme face aux logiques technico-économiques.
Car qui croire, en effet ? Les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d’accord ; les plus inquiets sont-ils des illuminés, qui ne savent plus quoi faire pour se faire remarquer ? Les défenseurs des technologies les plus controversées ne font-ils que protéger les disciplines qui organisent et financent leurs analyses ? Chaque camp propose ses méthodologies, ses analyses et ses conclusions, et invite à conclure, par exemple sur les cas du réchauffement climatique, de la pollution ou des effets possibles des OGM, qu’il n’existe pas de vérité définitive. Que signifie cette situation lorsqu’elle perdure ? Qu’il n’existe pas de vérité scientifique, ou bien que l’un des deux camps passe son temps à mentir ou se tromper ? Ou encore que notre niveau actuel de maîtrise de ces questions ne permet pas encore d’avoir les idées claires sur ces sujets ? A moins que ces sujets ne soient trop complexes, composés de trop nombreuses sous-disciplines scientifiques incapables de coordonner et synthétiser leurs analyses ? Qu’en quelque sorte un excès de spécialisation rende impossible la synthèse dans un domaine aux multiples considérants ? Ou bien encore que la vérité en ces domaines complexes ne ressortira pas de considérations scientifiques, mais peut-être de considérations morales, politiques, pourquoi pas économiques ?
D’ailleurs, peut-on s’en remettre à nos connaissances scientifiques en cas de catastrophe majeure ? Chacun se rappelle la ronde des scientifiques sur les médias pour nous abreuver de données contradictoires quant aux conséquences probables de l’accident nucléaire de Tchernobyl. Complexité et éclatement des savoirs, perte de crédit de l’expertise peuvent également déboucher sur un relativisme qui désamorcera toute velléité de maintenir ouvert le futur. Nous sommes à l’époque des connaissances à la carte, accessibles depuis un moteur de recherche. Dans ce contexte l’espace public risque de s’apparenter à une immense blogosphère, une accumulation d’informations mises en ligne au fur et à mesure de leur élaboration, sans validation préalable. Informations diverses prêtes à nous livrer des vérités sur demande. « La technologie appuyée sur la science, ou technoscience, est une sorte d’usine qui nous fournit de la vérité à la mesure de nos besoins. Ou, si l’on veut une autre image, elle est une planche à billets qui émet toute la vérité que nous voudrons. Nos dépenses étant d’emblée couvertes, nous pouvons nous permettre de jouer à mettre en doute la vérité. »[3] Et il ne servirait à rien de s’arrêter trop longuement sur ces questions scientifiques ou technologiques sans prendre la peine de les resituer dans le contexte technicoéconomique global qui les initie, les stimule, les sélectionne, les invite à se transformer ou non en produits et services marchands, à l’échelle planétaire.
Publication : Jean-François Simonin, Septembre 2013
[1] Louis Mumford, Les transformations de l’homme, p. 148-149.
[2] Lovelock, La revanche de Gaia, p. 6.
[3] Brague, Rémi, Modérément moderne, p. 214.
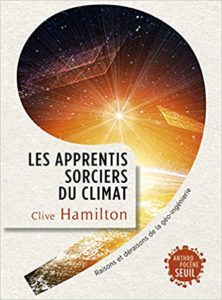
Le grand mérite du livre de Clive Hamilton est d’attirer notre attention sur une question qui va devenir un sujet d’actualité mondiale dans les années à venir. Car à horizon BH22, la géo-ingénierie représente un enjeu stratégique de la même nature que le nucléaire ou les OGM. En cas d’erreur, d’échec ou d’accidents malencontreux, l’avenir de l’humanité sur le long terme pourrait s’en trouver dramatiquement hypothéqué. Nous pouvons, c’est certain, avoir de sérieux doutes quant à la pertinence d’un projet de climatisation de la planète.
Pour comprendre la nature et l’importance des enjeux liés aux projets de géo-ingénierie climatique, il faut remonter à la prise de conscience de notre entrée dans l’ère de l’anthropocène. Nous quittons actuellement l’ère de l’holocène. Il s’est agi d’une période idyllique pour l’humanité, qui aura bénéficié pendant dix millénaires environ d’une clémence et d’une régularité climatique propice à un véritable bond en termes d’organisation sociale, de démographie, et d’exploitation du vivant. Mais l’homme s’est développé durant l’holocène avec un tel succès qu’il a acquis l’équivalent d’une force géologique. La population a été multipliée par dix et l’impact de l’utilisation des combustibles fossiles a eu des résultats si importants qu’ils ont fait entrer la planète dans une nouvelle époque géologique, l’ère de l’anthropocène. Selon la définition initiale de Paul Crutzen, éminent spécialiste du climat, l’anthropocène est caractérisée par le fait que « les activités humaines ont maintenant un impact si important et dynamique sur l’environnement global qu’elles entrent en rivalité avec les grandes forces de la nature en termes d’impact sur le fonctionnement du système Terre. » (p. 254) Contrairement à l’idée rassurante d’une Nature robuste et permanente, toile de fond immuable des activités humaines, les scientifiques en viennent à redouter que les activités humaines ne poussent le système Terre hors de l’état de grande stabilité qui avait caractérisé l’holocène. Pour Hamilton, il nous faudra encore des décennies pour mesurer toutes les implications de ce changement d’ère. Car le problème n’est pas seulement d’ordre météorologique, il implique de repenser toute notre vision de l’histoire. C’est toute la conception de l’autonomie de l’homme dans son rapport à la nature qui en est bouleversée – autant dire que c’est toute la pensée des Lumières qui achoppe sur de tels constats. L’idée même de distinction entre histoire naturelle et histoire humaine n’a plus de sens. A partir de l’anthropocène, la nature, toute la nature, devient une nature humaine. Il n’y a plus de nature sauvage.
Pour Hamilton c’est une intervention publique de Paul Crutzen, datée de 2006, qui a fait accéder la géoingénierie climatique au rang de préoccupation « sérieuse ». Crutzen estimait que « la solution de loin la plus préférable pour résoudre le dilemme des décideurs politiques consiste à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, jusqu’ici, les tentatives dans cette direction ont pour la plupart échoué ». (p. 215) En d’autres termes, le point de départ de la réflexion sur l’idée de géo-ingénierie résulterait, pour Hamilton, de l’échec patent de la communauté internationale à répondre aux alertes scientifiques sur les dangers du réchauffement climatique par diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Rétroactions et points de bascule sont les deux principales sources d’angoisse des spécialistes du climat qui redoutent de possibles effets de réaction pouvant amplifier ou atténuer les effets directs de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre sur le réchauffement. La prise de conscience du déclin spectaculaire de la banquise arctique estivale au cours de la dernière décennie a représenté un choc pour de nombreux spécialistes. Ces derniers craignent à présent de possibles réactions en chaine : fonte du permafrost, libération de grandes quantités de méthane dans l’atmosphère et autres effets déstabilisateurs très puissants. Et l’apparition des fameux points de bascule, dont la simple évocation suffit à anéantir l’idée jusque-là réconfortante selon laquelle l’accumulation lente de gaz à effet de serre entrainerait une modification progressive de la température, à laquelle nous pourrions remédier en temps utile.
D’où une déferlante de projets d’intervention d’ordre technologique pour prendre la main sur la question climatique. Selon Hamilton, on répertorie « … quelques quarante-cinq propositions de techniques de géo-ingénierie et leur variante. Entre huit et dix d’entre elles font l’objet d’une attention sérieuse. Certaines relèvent d’une conception extrêmement ambitieuse, d’autres sont sans imagination ; certaines sont purement spéculatives, d’autres ne sont que trop aisées à mettre en œuvre. » (p. 12) Parmi les solutions souvent citées : tenter d’interférer dans le grand cycle du carbone, altérer la composition chimique des océans ou y déverser de grandes quantités de chaux, accélérer artificiellement l’érosion des roches, modifier l’implantation naturelle des arbres, des sols et des algues dans de grandes proportions, purifier l’air de différentes façons, gérer le rayonnement solaire, éclaircir les nuages, modifier les cirrus, installer un bouclier solaire constitué d’une couche de particules de soufre injectées dans la haute atmosphère pour réduire la quantité de lumière solaire qui atteint la planète, créer un filtre solaire sur mesure… On le voit, il existe un grand nombre d’idées comprises sous l’intitulé géoingénierie climatique. On peut toutefois les classer en deux familles principales : celles qui consistent à « aspirer le carbone », et celles qui proposent de « maîtriser la lumière du soleil ».
Hamilton, après analyse des débats publics à ce sujet, identifie les trois justifications principales avancées par les promoteurs de la géo-ingérierie : elle permettra de gagner du temps (c’est un mal transitoirement nécessaire pour éviter un réchauffement climatique incontrôlé), elle permettra de répondre à une urgence climatique (c’est l’argument avancé par Crutzen, pour combler l’incapacité des politiques à réguler les émissions de gaz à effet de serre), et elle représentera la meilleure option économique possible (plusieurs analyses coûts/bénéfices ont été effectuées, et certaines avancent l’idée que la géo-ingénierie représenterait économiquement la solution du moindre mal, les coûts à engager aujourd’hui étant plus faibles que les manques à gagner ou les surcoûts de fonctionnement de la Terre à moyen terme, en cas de réchauffement important). En 2010 le Giec a décidé, pour la première fois, d’intégrer une évaluation de type géo-ingénierie comme réponse au réchauffement climatique dans les conclusions de son rapport. Ce qui a procuré un retentissement considérable à une idée qui restait jusqu’alors relativement hors de portée de toute stratégie réaliste.
La question est véritablement complexe. « La géo-ingénierie représente un profond dilemme, non seulement pour les scientifiques spécialistes du climat, mais également pour les écologistes. C’est une question à laquelle tous les citoyens vont bientôt être confrontés. Beaucoup de gens éprouvent de la répulsion à l’idée, que l’on retrouve dans certains projets de géo-ingénierie, d’une prise de contrôle du climat de la Terre dans son ensemble. Car il s’agirait certainement de l’expression ultime de l’arrogance technologique du genre humain. Pourtant, si l’alternative consiste à rester en retrait et à regarder l’humanité plonger la Terre dans une ère de changement climatique hostile et irréversible, que faire ? » (p. 32) Dans la mesure où le changement politique semble inconcevable, la seule solution est alors de gagner du temps, soit pour attendre que le coût des énergies renouvelables chute, soit pour nous préparer à faire face à un éventuel point de basculement du climat. Mais dans un sens, avec la géo-ingénierie, on entérine le fait qu’il n’est pas question de modifier le mode de vie des humains. On chercherait plutôt à transformer le monde dans lequel vivent ces humains. Les plus grands dangers liés à la géo-ingénierie émanent des apprentis sorciers qui font la promotion du « bon anthropocène », et multiplient les recherches de toute solution technoscientifique capable d’influer sur l’évolution du climat. En effet, l’ingénierie du climat est une idée intuitivement séduisante pour la pensée technologiste occidentale et ses politiques conservatrices, qui refusent toute politique qui s’orienterait délibérément vers une modification des modes de vie occidentaux. Et dans ce contexte, certains scientifiques font bon ménage avec des industriels peu scrupuleux pour inviter à modifier délibérément le climat. Pour eux, l’anthropocène, littéralement l’âge de l’homme, est une invitation à assumer un contrôle total de la planète. Pour eux, ce nouveau rôle joué par l’humanité à l’échelle planétaire constitue une « formidable opportunité » de concevoir divers scénarios de type géo-ingénierie. Et de nouvelles opportunités de générer du business, tout simplement.
Mais avec l’anthropocène, le mythe d’un progrès sans fin, profitant à l’humanité entière par ruissellement, ne tient plus. « La question qui se pose est donc de savoir quelle proportion du reste du monde sera sacrifiée pour prolonger le rêve de l’abondance » pour quelques-uns. (p. 280) C’est dans ce contexte qu’il faut interroger la possibilité du recours à la géo-ingénierie : va-t-elle être utilisée pour sauver la croissance telle qu’elle est aujourd’hui conçue, ou pour nous donner les moyens de faire émerger les nouvelles valeurs que requiert l’anthropocène ? « Nous voyons les climatosceptiques influents des États-Unis et d’ailleurs se tourner vers la géo-ingénierie, tandis que les politiciens conservateurs commencent à y voir un intérêt électoral. Les grands prêtres du culte de Prométhée et les défenseurs du libre marché sont naturellement attirés par la géo-ingénierie. Son intérêt stratégique devrait progressivement entrainer sa militarisation. La pensée technique structure notre conscience de mille manières différentes qui rendent l’ingénierie du climat séduisante et, en conséquence, pratiquement inéluctable… Dans les décennies à venir, nous verrons si la tentative de modification délibérée du climat est une noble audace ou une folie désastreuse. » (p. 282-283)
Publication : Jean-François Simonin, Juin 2016.
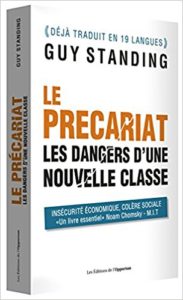
Le terme précariat aurait été utilisé pour la première fois par des sociologues français dans les années 1980, pour désigner les travailleurs temporaires et saisonniers. Pour Standing, économiste anglais spécialiste des questions d’insécurité, le précariat n’est pas seulement un néologisme de plus. C’est une réalité mondiale qui force nos sociétés à changer pour éviter l’explosion sociale. Standing estime que la notion de précariat puise ses références culturelles principalement chez Bourdieu, Foucault, Habermas, Negri et Hardt et, en toile de fond, chez Arendt et Marcuse.
Pour Standing, seuls l’élite et le salariat en contrat indéterminé sont à l’écart de la menace du précariat. Toutes les autres catégories d’individus sont menacées de sombrer dans la « trappe à précariat » tendue par les politiques néolibérales. « Il en résulte que de plus en plus de gens se retrouvent dans des situations que l’on ne peut que qualifier d’aliénées, anomiques, anxiogènes et propices à la colère. Et le signal d’alarme est le désengagement politique. » (p. 76)
Standing estime qu’actuellement le précariat représente environ le quart de la population adulte mondiale, tout en précisant qu’un recensement précis est impossible. D’autant, on l’imagine aisément, que de multiples définitions de ce précariat sont possibles. Mais, estime-t-il, on peut aller jusqu’à considérer que le précariat pourrait à moyen terme toucher la quasi-totalité de la population mondiale, exceptée l’élite de la mondialisation : la crise écologique est telle que seule une infime minorité peut espérer se tenir à l’abri de certains dégâts environnementaux à venir. « Grâce à leur richesse et leurs relations, ils ne sont pas directement affectés. Ils peuvent toujours se retirer sur leurs îles paradisiaques ou dans leurs confortables chalets à la montagne. Tout ce qu’ils veulent, c’est que de forts taux de croissance continuent à gonfler leurs revenus et leur fortune. Ils n’ont que faire des dégâts environnementaux inhérents à l’épuisement des ressources. » (p. 447)
Standing recense un grand nombre de situations précaires : migrants, salariés, jeunes, vieux, handicapés… L’idée même du précariat remonterait à l’Empire romain, qui autorisait certains étrangers à s’installer sur son sol, mais sans bénéficier de tous les droits des citoyens romains. Aujourd’hui, ce décalage s’observe sur plusieurs types de droits : « civiques (égalité face à la justice, droit d’être protégé de la délinquance et de la violence physique), culturels (égalité de l’accès à la culture et droit de participer à la vie culturelle de la communauté), sociaux (égalité d’accès aux diverses formes de protection sociale, dont la retraite et les soins médicaux), économiques (égalité dans le droit d’exercer une activité générant un revenu), politiques (égalité des droits pour voter, se présenter à des élections et participer à la vie politique de la communauté) » (p. 52)
La pensée et les pratiques néolibérales sont selon Standing à l’origine du développement de ce précariat : flux tendus, turn over élevé, flexibilité maximale des facteurs de production, tactiques opportunistes, publication des comptes trimestriels, marchés financiers fonctionnant à la milliseconde, communication en temps réel, tout cela diffuse une précarité généralisée dont la prise en charge n’est de la responsabilité de personne. « L’ère de la mondialisation est arrivée avec un pacte social rudimentaire » : les travailleurs devaient accepter la flexibilité du travail en contrepartie de mesures pour préserver les emplois, afin que la majorité connaisse une hausse de niveau de vie. Il s’agissait, en fait, d’un pacte faustien. « Selon le FMI, la Banque mondiale et divers autres organismes influents, une faible sécurité de l’emploi est nécessaire pour attirer et conserver les capitaux étrangers. S’étant conformés à ces recommandations, les gouvernements rivalisent pour affaiblir la protection de l’emploi et faciliter l’embauche de main-d’œuvre dans ces conditions. » (p. 94-95) Pour Standing ces pratiques néolibérales sont des « trappes à précarité ». Mais le précariat évolue, et vite. Par exemple la nouvelle vie numérique, dont la fameuse technologie du surf, représente peut-être une nouvelle introduction au précariat dans la mesure où elle nuit au renforcement de la mémoire à long terme : il se pourrait que l’aptitude à raisonner via des processus complexes, à parvenir à de nouveaux concepts ou de nouvelles façons d’inventer, soit fragilisée par Internet, les moteurs de recherche, Twitter et tous les autres réseaux sociaux qui contribuent à la restructuration des cerveaux et, peut-être, à modifier ce que des générations avaient fini par considérer comme l’intelligence. « L’esprit instruit est menacé parce qu’il est constamment bombardé de giclées d’adrénaline par voie électronique ». (p. 64)
Le précariat est selon Standing « une nouvelle classe dangereuse ». En Europe comme aux US, le mécontentement de tous ceux qui ont été chassés de la traditionnelle « classe ouvrière » se transforme en ressentiment de masse, soit pour agir collectivement sous forme de représailles envers les responsables présumés de ce précariat, soit pour devenir des cibles de choix pour tous les leaders populistes qui attisent facilement la haine envers les SDF ou les migrants, qui représentent pourtant de nouvelles sections de précariat. « Les membres du précariat n’ont pas le sentiment d’appartenir à une communauté professionnelle solidaire. Ils ont surtout celui d’être tenus à l’écart et instrumentalisés. A cause de la précarité, leurs actions et leurs attitudes finissent par dériver vers l’opportunisme. Aucune perspective d’avenir ne leur permet de penser que ce qu’ils disent, font ou ressentent aujourd’hui aura des répercussions à long terme. » (p. 49) En fait, le précariat se définit comme l’obligation de fonctionner à court terme. Et cela pourrait évoluer en incapacité définitive de penser à long terme. Evolution particulièrement problématique pour appréhender BH22. Dans le précariat il est difficile de maintenir une estime de soi durable. Nombreux sont les gens à entrer dans le précariat pleins de colère et d’amertume. Pourquoi la majorité des individus semble insensible à l’augmentation de ce phénomène ? « La pensée que le précariat est une classe émergente dangereuse devrait pourtant les inquiéter. Un groupe qui ne se voit aucun avenir en termes d’identité et de sécurité économique va forcément ressentir une peur et une frustration qui pourraient bien le conduire à riposter contre les supposées causes de son sort. Et à force de ne jamais pouvoir bénéficier des retours financiers et des progrès de l’économie traditionnelle, ces gens pourraient bien finir par sombrer dans l’intolérance. » (p. 77)
Pour imaginer des pistes de sortie, Standing s’appuie beaucoup sur la pensée de Polanyi, qui faisait de la réinsertion de l’économie dans le primat d’une vie sociale et politique proactive la clé de voûte d’une stratégie adaptée aux enjeux de son époque. Il invite à lutter sur cinq fronts simultanément : « l’insécurité économique, le temps, ‘l’espace vital’, le savoir et le capital financier. » (p. 428) Le précariat n’est pas encore une classe sociale en soi, dit-il. Elle demeure en gestation, mais elle sait chaque jour davantage de qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas. Elle ne veut pas, par exemple, retrouver le modèle travailliste du XXe siècle, car elle en croit plus à l’idéal progressiste qui servait de fondement à ce modèle. « Nous avons besoin d’une nouvelle politique paradisiaque – modérément utopiste et fière de l’être. » (p. 393)
Concrètement, Standing voudrait « redonner la priorité à l’éducation émancipatrice et tenir tête aux chantres de la marchandisation. » (p. 402) et il cite pour appuyer son propos un texte de Mill écrit en 1867: « Les universités n’ont pas vocation à enseigner les connaissances nécessaires aux hommes pour gagner leur vie d’une manière déterminée. Leur objectif n’est pas de fabriquer de bons avocats, médecins ou ingénieurs mais des êtres humains capables et cultivés. » (p. 403) Il promeut aussi l’idée de revenu universel, « versé à chaque individu et non à une entité aussi aléatoire qu’une famille ou un foyer ». « Chaque individu disposerait d’une carte pour répondre à ses besoins essentiels ou dépenser l’argent à sa guise, avec des sommes supplémentaires dans les cas de besoins particuliers, tels que le handicap. » (p. 430) Enfin, « le précariat doit être représenté institutionnellement et exiger que les politiques reposent sur des principes éthiques. En ce moment, il existe un vide institutionnel que seules une poignée de courageuses ONG s’efforcent de combler comme elles peuvent. « (p. 417)
Publication : Jean-François Simonin, juillet 2017.
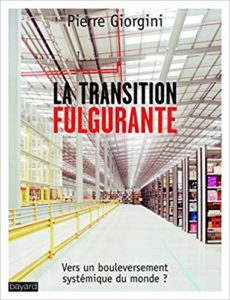
L’ouvrage est composé pour une moitié d’une thèse de Pierre Giorgini sur son concept de transition fulgurante, et pour l’autre moitié d’une controverse avec des universitaires de disciplines diverses qui partagent avec lui certaines recherches et expérimentations en innovation sociale, souvent dans le cadre de l’Université Catholique de Lille.
La transition fulgurante, c’est d’abord l’intuition que les technosciences « bio, nano et numériques » préparent de profondes reconfigurations des objets et services dont nous avons l’usage quotidien. Une complète reconfiguration du monde et de nos façons d’habiter ce monde pourrait en résulter : nos modes de consommation, notre culture, notre santé et au total nos modes de vie pourraient s’en trouver bouleversés dans des proportions dont nous peinons à imaginer l’importance et la radicalité. Car le tout numérique, vers lequel nous avançons quotidiennement, permet la combinaison de nombreuses avancées technologiques entre elles. Giorgini tente de décrypter et de cartographier l’ensemble de ces transformations en cours. C’est l’intérêt essentiel de son livre, précieux pour une réflexion à horizon BH22. Giorgini identifie pour cela 6 « actants de base », qui représentent autant catégories relativement homogènes de ruptures en cours d’émergence, et repère 3 grands phénomènes majeurs de transformation de l’humanité. Ces 6 actants sont :
Sachant que la puissance transformatrice de chacun de ces 6 actants est multipliée par la combinaison possible entre actants, et par toutes les fonctionnalités qu’elle peut impacter au travers de différentes ruptures non anticipables. « La combinaison de ces 6 actants majeurs constitue en effet une source de transformation inépuisable. » (p. 82) Au total, résultat de ces multiples combinaisons possibles, trois phénomènes majeurs sont en cours de matérialisation : « La virtualisation « quasi réalité » (hologrammes, synthèse numérique d’images quasi réelles…), l’humanisation des machines (intelligentes, dotées de langage, capables de se reproduire et de travailler en coopération) et la « machinisation » de l’homme (augmenté, outillé, démultiplié, hypermobile). Nul ne sait où cette tendance de fond nous conduira ou s’arrêtera. Mais ses effets sont à leur tour combinés avec une autre transformation qui interfère avec cette révolution technoscientifique, à savoir le changement de paradigme global des systèmes de coopération technique et humaine. » (p. 84)
Mais pourquoi y aurait-il quelque chose de plus fulgurant aujourd’hui qu’hier ? Parce que parmi toutes les évolutions enregistrées dans l’histoire de l’humanité – et elles ont été nombreuses sur les dix derniers millénaires : sédentarisation, urbanisation, domestication des animaux, renforcement des moyens de stockage, de transport et de reproduction, naissance des premières religions, apprentissage de la guerre… – la transition dont on parle aujourd’hui « est quasi instantanée à l’échelle du temps paléontologique. Elle est globale, dynamisée et alimentée en permanence par la fulgurance d’innovations technoscientifiques radicales, dont la multitude et la combinatoire interne font exploser le champ des possibles. » (p. 190) Cette fulgurance tient à quatre différences majeures avec toutes les autres mutations qu’a connue l’humanité : l’envergure des changements concomitants (ces changements sont mondiaux, simultanés, sans frontière géographiques ni culturelles, et nul sur la planète peut dire qu’il n’est pas concerné), la temporalité de ces changements (la lente sélection des animaux plus performants, au début de la domestication des espèce, restait voisine du temps biologique, elle n’avait rien à voir avec nos techniques OGM fulgurantes), la radicalité (les disruptions, autrefois rares et locales, sont aujourd’hui nombreuses, et profondes, capables de perturber totalement plusieurs siècles de progrès incrémentaux dans tel ou tel secteur d’activité), et la multiplicité des innovations technologiques (la combinatoire des actants fait exploser le champ des possibles).
Au final, dit Giorgini en s’inspirant des travaux de l’anthropologue Alain Testart, nous sommes face à la problématique de la domestication de l’homme par lui-même. Cette fulgurance pose un problème bien spécifique de vitesse : « L’homme aura-t-il le temps de se « domestiquer » lui-même dans cet écosystème en bouleversement fulgurant ? » (p.192) Question cruciale au moment où l’on parle d’homme augmenté, de posthumain, parfois en y consacrant de lourds moyens humains et financiers, comme l’a fait entre autre Google avec la création en 2013 de sa filiale Calico, dont l’ambition affichée est d’améliorer l’espèce humaine, de la réparer, de la libérer de ses vulnérabilités biologiques et d’augmenter ses capacités physiques et cérébrales.
On voit qu’il pourrait bien y avoir au final, effectivement, « changement systémique du monde ». Giorgini s’interroge sur l’interdépendance croissante des hommes en tant que gestionnaires d’un destin planétaire commun. Il approuve la recherche lancée par le mouvement convivialiste pour définir un fond doctrinal commun et adapté à ces enjeux qui, n’étant cadrés par aucune échelle de valeur, semblent dériver au gré de l’initiative privée des uns ou des autres. Si l’on y prend garde, ce nouveau monde pourrait s’apparenter à un Far West où sont peut-être déjà en cours d’installation la loi du plus fort, les milices, la justice par soi-même – selon la conception que chacun, dans un monde si changeant, pourra s’en faire. « Comment gérer la rivalité et la violence entre les êtres humains ? Comment les inciter à coopérer tout en leur permettant de s’opposer sans se massacrer ? Comment faire obstacle à l’accumulation de la puissance, désormais illimitée et potentiellement autodestructrice, sur les hommes et sur la nature ? » (p. 162)
Giorgini se veut optimiste, invite à regarder de l’avant, mais prévient : « Les technologies qui apparaissent ouvrent également à des scénarios catastrophes si l’homme est dans l’incapacité d’en contrôler l’usage, voire le développement, au nom d’une idée supérieure de l’homme et de son humanité. Ce contrôle doit être planétaire, une fonction de police globale. Une course-poursuite est donc engagée entre le progrès technoscientifique et la capacité pour l’humanité d’en contrôler l’usage. » (p. 200) Et Giorgini de clôturer son livre sur ces mots : « C’est, je crois, notre seule chance de sortir de cette tension ravageuse et montante qui oppose l’humanité qui nous a été donnée et celle que nous avons à créer. » (p. 202)
Publication : Jean-François Simonin, février 2016.

Andreas Malm est un spécialiste suédois de géographie humaine. Il jette de ce fait un regard original sur la question de l’anthropocène et l’intérêt principal de son livre, dans une optique de réflexion à long terme, réside dans la façon dont l’auteur cherche à identifier le moment et les moyens de « l’embrasement » économique qu’aura rendu possible le recours aux énergies fossiles. C’est, dit-il, le meilleur moyen d’espérer comprendre les véritables raisons du suicide écologique en cours – et peut-être de trouver des solutions adaptées à nos questionnements actuels.
On connait le fond du diagnostic « anthropocène » : ce n’est plus la nature, c’est la nature humaine qui représente le plus puissant facteur d’évolution de la biosphère – de sa température, de la composition de sa biodiversité, des cycles de l’azote ou du CO2, de l’empreinte écologique globale de l’humanité. L’histoire dira peut-être qu’il s’agit de la plus grande découverte scientifique du XXI e siècle. Mais en attendant, ce sont des géologues, remarque Malm, ou des météorologues, des biologistes et des scientifiques d’autres disciplines qui ont compris les premiers l’importance du concept d’anthropocène. Les économistes, les hommes politiques et les médias n’y ont prêté aucune attention, ou ont cherché et cherchent toujours à en minimiser la signification. Ceci dit, il faut avouer que si le concept d’anthropocène permet un diagnostic solide, il peine à identifier les responsabilités et à trouver des voies de sorties praticables, pour l’humanité dans son ensemble, de cette ère bien problématique pour la capacité de survie de l’humanité.
Malm passe outre les réflexions actuelles de certains scientifiques qui hésitent, à définir le véritable point de commencement de l’ère de l’anthropocène. Naissance de l’agriculture, de la machine à vapeur ou de l’énergie nucléaire sont les hypothèses les plus souvent avancées. Mais pour Malm, le fait historique fondamental du réchauffement climatique résulte de la consommation à grande échelle des combustibles fossiles. Le climat de la Terre est certes le produit du passé, mais pas d’un passé lointain, qui se compterait en ères ou en milliers d’années. C’est le produit accidentel d’une petite partie de l’humanité qui, en Occident, a bifurqué brusquement de ses traditionnelles voies d’occupation de la planète pour, sur les deux derniers siècles, mettre le feu à des combustibles fossiles et remplir l’atmosphère de dioxyde de carbone dans des proportions incompatibles avec le maintien des équilibres écologiques millénaires de la biosphère.
Malm porte un gros coup projecteur sur « l’association du combustible du charbon et de la rotation d’une roue », association qui représente pour lui le point de départ du processus général de croissance économique (production, transport, consommation) au sens où on l’entend aujourd’hui. Il précise son propre point de vue sur la question : ce n’est pas la seule invention de la machine à vapeur, brevetée par James Watt en 1784, qui a produit l’embrasement de l’économie fossile. Car « un brevet seul ne suffit pas à créer quelque chose comme une économie fossile ». C’est, dit-il, le moment où, dans l’Angleterre du début du XIXe siècle, l’industrie du coton est passée de l’eau à la vapeur, vers les années 1820-1830. C’est à ce moment que la société britannique est passée d’une « économie organique » à une « économie fossile ». Dans le cadre d’une économie organique tout acteur reste limité par les ressources de la photosynthèse présente : superficie terrestre, force des vents, rayonnement solaire, traction animale… Une économie organique reste enfermée dans les limites des ressources renouvelables, de surcroit en compétition avec l’ensemble du vivant, dans une logique d’équilibre. « La dépendance à l’égard de la terre fixe un plafond bas à la production industrielle. Les combustibles fossiles font voler en éclats ce plafond. » (p. 73)
Car, miracle : le recours au charbon permet d’échapper aux malédictions ricardienne (les lois de la nature limitent les pouvoirs productifs de la terre) et malthusienne (incompatibilité entre les dynamiques de démographie et de production). « Creusant dans les réserves de la photosynthèse passée, et contournant la restriction fixée par la limitation de la surface touchée par le rayonnement solaire, elle a fini par rompre le maléfice de la stagnation ». (p. 76) L’énergie fossile libère l’homme de son assujettissement à la superficie. La production du charbon britannique a libéré l’équivalent de la superficie de la Grande Bretagne, lui procurant alors un avantage compétitif décisif, et donnant l’illusion d’une possible croissance main dans la main de la population et de l’économie. Malm s’appuie sur la célèbre thèse de Kenneth Pommeranz et précise : il y a similitude entre la façon dont l’Angleterre a multiplié son accès aux ressources naturelles grâce à la colonisation, à l’utilisation de l’énergie fossile, au XIXe siècle, et les stratégies contemporaines de délocalisation, qui représentent simplement une autre forme d’externalisation des contraintes écologiques.
Pour Malm, la mise à jour de cette façon de voir l’histoire conduit à rompre avec l’idée de la croissance comme ambition humaine innée, commune à toutes les époques et à tous les modes de production. Lorsque l’on saisit bien le rôle joué par l’énergie fossile dans l’embrasement de cette croissance, on peut repenser radicalement les forces à l’origine de la destruction écologique actuelle. Il ne faudrait pas voir ces forces « comme des aspirations archaïques de l’espèce humaine, comme une éternelle ambition de croissance se heurtant aux murs de la rareté et les dépassant en substituant les biens abondants aux biens rares : un processus universel se déroulant comme une réaction à des contraintes spécifiques. Le contraire semble plus juste. Le capital est un processus spécifique qui se déroule comme une appropriation universelle des ressources biophysiques, car le capital lui-même a une soif unique, inapaisable, de survaleur tirée du travail humain au moyen de substrats matériels. Le capital, pourrait-on dire, est supra-écologique, un omnivore biophysique avec son ADN social bien à lui. » (p. 137) Les principes de flux tendus et de lean production représentent une poursuite, au début du XXIe siècle, de ce mode d’exploitation des ressources provocateur à l’égard des limites physiques de la biosphère. Le concept d’anthropocène devrait conduire à l’inversion de nos principales valeurs. Il impose de passer de l’étude du climat dans l’histoire à l’étude de l’histoire dans le climat. L’anthropocène matérialise la prédiction de Walter Benjamin selon laquelle « on doit s’attendre aux manifestations de déclin comme à quelque chose d’absolument stable, et au salut uniquement comme à quelque chose d’extraordinaire, qui touche presque au miraculeux et à l’incompréhensible. » (cite p. 56)
Pour Malm, l’essentiel consiste à démonter les rouages de l’économie fossile : la série de technologies énergétiques qui ont succédé à la vapeur – notamment de l’électricité et du moteur à combustion interne – ont été introduites au travers de décisions d’investisseurs, parfois avec le soutien de certains gouvernements, mais jamais suite à des délibérations démocratiques. Redonner la main au politique sur ce type de question devient, à l’ère de l’anthropocène, une question de survie collective. A défaut, les dangers les plus saillants de cette situation seront des risques de dérives en « fascisme écologique », ou « de haine de classe écologique », avec des populations nourrissant un ressentiment de plus en plus fort envers la minorité qui détient les rênes du pouvoir fossile, « le noyau dur du capital fossile ». (p. 204)
Publication : Jean-François Simonin, Août 2017.

Il existe plusieurs bonnes raisons de lire ce tome IV de l’avènement de la démocratie de Marcel Gauchet dans l’optique d’une projection à horizon BH22. J’en retiendrai principalement une dans cette brève présentation : le décryptage, par Gauchet, de ce formidable paradoxe qui veut que la poursuite de l’autonomie du sujet aboutisse aujourd’hui à une société qui échappe à ses membres, à une démocratie qui semble se crisper autour de ses plus vieux démons, une humanité qui voit son destin lui échapper. Et plus précisément encore, je centrerai ce modeste résumé autour de ce constat décidemment surprenant qui veut que la quête des droits individuels parraisse finalement un projet suspect.
Ce volume analyse, comme les précédents ouvrages de Gauchet, les phases ultimes de la « sortie de la religion ». Jusqu’à très récemment notre monde restait soumis aux puissances venues d’en haut. Nous pensions être tirés par les projets et la construction d’un paradis sur terre, nous nous apercevons que nous restions hantés par la question des origines et du passé. La place hégémonique prise par l’économie mondialisée a masqué un temps cet état de fait, mais il ressort à présent au grand jour. Tandis que nos lointains ancêtres scrutaient nerveusement le passé pour y puiser leurs raisons d’être et de vivre ensemble autour de leur scrupuleux respect de la tradition, tandis que nos plus proches ancêtres -nos parents et nos grands-parents- se passionnaient pour le progrès technologique et toutes sortes de projets de transformations matérielles du monde, nous restons à présent collés à notre présent sans questions ni perspectives – sans angoisses mais aussi sans espoir. Le retrait du religieux « a laissé place au sentiment postmoderne d’un devenir en forme de chaos événementiel sans liens ni ligne. C’est sur sa base que s’était déployé le spectre des idéologies guidant l’action collective. Son effacement laisse une scène publique sans perspectives fédératrices et mobilisatrices. » (p. 388)
Face aux dérives nationalistes, aux aberrations écologiques et aux périls technoscientifiques contemporains nous restons comme interdits devant le constat d’un immense gâchis, d’une promesse non tenue. « C’en est irrévocablement terminé de la promesse exaltante qui habitait, si confusément que ce soit, la conscience des acteurs du devenir, la promesse selon laquelle plus nous avançons dans l’histoire que nous faisons, mieux nous comprenons ce qui a été fait et mieux nous savons qui nous sommes. Ce qui s’étend devant nous, c’est une interminable succession de présents tous semblablement relatifs. « (p. 409) On dirait que la conscience historique, devenant conscience d’elle-même, se rend simultanément critique à l’égard de ses propres ambitions initiales. « Bref, le sentiment du devenir et l’impératif de s’orienter en fonction de lui ont beau être plus vifs que jamais, ils tendent à concentrer l’attention sur une zone étroite où ne comptent guère, hors de l’intensité du présent, que le passé et l’avenir proches – le passé, afin de dégager la nouveauté du présent de sa gangue héritée, l’avenir, afin de vérifier l’efficacité de la liberté d’invention qui est l’âme du présent. » (p. 410)
Il faut comprendre comment les propositions néolibérales se sont d’abord imposées comme théories critiques – critique du rôle des États, critique des totalitarismes, critique de l’inflation. Elles étaient inspirées par le projet de pousser plus à fond l’idéal des Lumières qui consistait à poursuivre le programme d’autonomisation de chaque individu. Mais cet individu, contre toute attente, se retrouve à présent pris en sandwich entre ses rôles de salarié, consommateur, citoyen. Il ne se reconnait plus dans ce qui était censé le maintenir dans la société. Il y a eu subrepticement transformation du politique, de l’histoire et du droit – et l’individu occidental a basculé sans s’en apercevoir dans un registre au sein duquel il devient étranger à lui-même et aux autres. D’où « l’illusion, en la circonstance, d’une individualisation qui en vient à se retourner contre la socialisation qui lui prête ses assises ». (p. 209) La recherche d’efficacité fait office de métaphysique mondialisée, les benchmarks deviennent la seule réalité objective qui vaille, les impératifs financiers font office de surmoi collectif, les objectifs individuels se matérialisent dans des routines d’asservissement collectif. Voici, écrit Gauchet, « les faits saillants de la situation actuelle : le retrait du politique, le désinvestissement de la projection dans l’avenir, la poussée des droits individuels… Il est vrai que la généralisation planétaire de ces produits typiques de la modernité que sont le calcul économique et l’invention technique emporte avec elle un prodigieux effet de sens, qu’elle crée un système cohérent d’apparences, qu’elle secrète, pour ainsi dire, sa propre lecture. » (p. 211)
Gauchet fait un zoom sur le statut des droits individuels dans l’organisation collective. La dissipation de la structuration des sociétés par la forme religieuse touche à la fois le politique et tout mode de déploiement de l’activité collective. Elle touche aussi les individus dans ce qu’ils ont de plus personnel. Pour le comprendre il faut revenir sur la façon dont les « droits naturels » sont devenus les « droits de l’homme » : par une alliance très conjoncturelle de l’histoire et du droit. Au début de l’histoire libérale, l’individu réel, celui qu’il s’agit d’aider à naître, c’est le propriétaire, l’être doté d’une existence indépendante, d’une capacité d’accumuler certains biens de subsistance. « Réduire le périmètre du pouvoir pour accroitre le territoire des droits personnels, dans un jeu à somme nulle où ce qui est gagné par l’un est perdu par l’autre et vice versa : telle était la perspective. » (p. 532) Mais c’est peine perdue : historiquement cette perspective s’est trouvée mise à mal, successivement par le machinisme, l’industrialisation, la financiarisation et à présent par la numérisation et la robotisation, qui confisquent à l’homme ses plus traditionnelles zones d’intimité avec lui-même. « Autant de phénomènes qui ont pour effet de mettre en crise l’idée libérale d’individu. Ils disqualifient la figure de cette autosuffisance ou de cette autarcie propriétaire que la société de l’histoire avait paru consacrer dans une phase antérieure. Ses développements obligent à réviser cette vue naïve. La vérité est que l’individu ne pèse pas lourd, réduit à ses seuls moyens. C’est l’organisation qui crée la force collective, et ce n’est que dans le cadre de l’organisation que l’individu peut donner sa mesure. Il est à réinsérer dans le collectif, car c’est à cette échelle que se joue son sort. » (p. 532)
Certes la consommation a représenté une transformation anthropologique de grande ampleur. Elle a changé les êtres jusqu’au plus profond d’eux-mêmes, dans leur longévité, leur santé, et peut-être dans une certaine intensité vitale offerte à chacun dans les démocraties contemporaines, mais c’est au prix d’une destruction inattendue de l’existence collective. « Présentéisme et individualisme marchent ensemble. Hier, la figure de l’avenir mobilisait les acteurs en tant que constructeurs de la cité finale. Aujourd’hui, elle les réduit au rang de spectateurs du désordre producteur dont ils participent anonymement. « (p. 404) A force de chercher à faire croître nos droits individuels nous avons éteint les lumières d’autrui et du monde, nous avons réduit notre capacité de projection à la petite zone qui entoure l’individu et le reste semble se perdre dans le non-sens. Comment la recherche de droits individuels a-t-elle pu se traduire par un raccourcissement des horizons collectifs ? C’est, écrit Gauchet, le monothéisme des droits de l’individu qui s’est installé en lieu et place de polythéisme des valeurs. Le retrait du religieux « a laissé place au sentiment postmoderne d’un devenir en forme de chaos événementiel sans liens ni ligne. C’est sur sa base que s’était déployé le spectre des idéologies guidant l’action collective. Son effacement laisse une scène publique sans perspectives fédératrices et mobilisatrices. » (p. 388). « Les trois grands scénarios idéologiques entre lesquels se répartissaient les choix politiques ont vu leur vraisemblance s’évanouir de conserve. L’espoir révolutionnaire s’est éteint en même temps que la foi réactionnaire ou la confiance dans le progrès. » (p. 387)
Notre idée de l’avenir était si obstinément focalisée sur l’invention technique et l’expansion économique qu’elle en a rendu aveugle le travail du devenir. Nos modes de fabrication de l’histoire se sont détournés de l’histoire que nous étions en train de faire. L’obéissance aveugle aux lois du marché a représenté l’immense avantage de nous contraindre à faire l’histoire sans avoir à y réfléchir. Il nous suffisait de dérouler les routines du libéralisme économique. Le tournant néolibéral du milieu du XXe siècle, après avoir donné l’illusion durant quelques décennies de se rapprocher encore de cet idéal, achoppe sur l’atomisation du monde. Et nul ne sait encore ce qu’engendreront, ensemble, individualisation et numérisation. L’ère de la connivence tacite entre progrès et développement technicoéconomique est bien terminée. Forme trompeuse de l’individualisation matérielle du domaine humain, le progrès tel que nous l’avons conçu jusqu’ici rend le monde humain étranger à lui-même et à ce qui l’entoure. Ce progrès a construit un tel niveau d’ignorance du sujet sur lui-même et son milieu de vie que nous pouvons – nous devons – compter sur un sursaut de la pensée pour retrouver tôt ou tard le sens de la liberté des devoirs qui devront lui être associés. L’enfermement dans notre présent consumériste n’est peut-être que provisoire. Notre situation n’est peut-être pas sans issue. Ce qui parait « acquis, c’est qu’elle réouvre, à une échelle jamais vue, la question de ce que l’humanité peut faire de son pouvoir de disposer d’elle-même »… et « … la structuration autonome n’est pas le dernier mot de l’autonomie. » (p. 209)
Publication : Jean-François Simonin, Mai 2017.
La technoscience contemporaine permet des actions d’un ordre tellement nouveau, crée des objets tellement inédits, qui impliquent des conséquences anthropologiques et ontologiques tellement bouleversantes qu’ils modifient radicalement la nature de l’avenir de l’humanité : certaines de ces nouveautés semblent élargir les potentialités humaines, d’autres semblent les réduire, tout cela sans que l’anticipation ou la volonté humaine n’y soient pour quoi que ce soit : ces innovations résultent de micro nouveautés qui, s’imbriquant et se démultipliant les unes les autres aboutissent à des reconfigurations irréversibles de l’environnement humain. A force d’études de marché, d’innovations technologiques, de stratégies marketing, de naissance de nouveaux besoins, de rapports de forces … les perspectives de l’humanité s’en trouvent bouleversées. Sloterdijk avait tenté d’aller au bout de cette logique dans son texte fameux Règles pour le parc humain. S’il est vrai que la destinée de la civilisation est d’aller de crise en crise vers l’accroissement des inégalités et du mal-être généralisé, vers la destruction de l’environnement, vers une dispersion de la puissance qui nous exposera tôt ou tard à une destruction de l’humanité, le mieux est peut-être de profiter des possibilités de reconfigurations actuellement envisageables de l’humain (biotechnologies, pharmacologie) pour tenter d’en téléguider l’évolution. Ne pas tenter cette chance, c’est peut-être risquer de passer à côté d’une opportunité historique d’éviter la catastrophe – estimée par ailleurs inévitable. Notre destinée serait alors d’aller au bout de nos capacités d’intervention sur l’humain et la planète, parce qu’en l’état actuel de son développement, la civilisation occidentale ne peut plus se contenter de rester sur ses rails actuels sans prendre ce type de risque. Parce que l’anthropocène nous montre que nous avons déjà dépassé des seuils de retournement dans les équilibres de la biosphère, et que les sédiments cumulés de nos activités anthropo-industrielles ne pourront s’évaporer ou se dissoudre sans laisser de traces « mortelles » pour notre avenir.
Mais le ressentiment contre la technique ne peut mener nulle part. Certaines communautés peuvent tout juste s’enfermer temporairement dans un imaginaire pré technique, mais cela ne parait pas durablement vivable. Nous ne pourrons certainement pas faire l’économie de repenser notre ontologie au contact de la machine d’un côté, et au contact d’un monde réanimé de l’autre. Une réflexion sur l’anticipation ne peut éviter de regarder dans ces directions où la dimension psycho historique de l’homme impose de sortir des dualismes cartésiens, de quitter les bases assurées du matérialisme et de l’idéalisme pour plonger dans cet entre-deux où une grande partie du monde environnant de l’homme est à présent fait de sa propre main, tandis qu’une autre partie, côté biosphère, ne se laissera jamais intégrer à ses calculs manipulatoires. Comme l’exprime Sloterdijk, il faut devenir technologue à l’époque contemporaine pour pouvoir être humaniste, mais « d’une technoculture qui veut être plus qu’une barbarie pragmatique à succès… si l’on parvenait à intégrer les machines intelligentes de l’avenir dans les relations semi-personnalistes et semi-animistes avec les humains, on n’aurait pas à redouter de voir l’homme lier amitié avec son robot. »[1]
Notre situation actuelle, avec ses constats hérités du passé et ses projets de transformation pour le futur, pose un redoutable problème à la recherche des conditions de possibilité de l’anticipation collective. Nous pressentons des changements si radicaux qu’on ne peut les inclure dans aucune prévision rationnelle. La sorte de pronostics dont nous aurions besoin risque d’être hors de portée de l’imagination, tout comme de l’intelligence prédictive au sens strict. Mais l’aptitude à affronter l’existence dans toutes ses dimensions, cosmique et humaine, est aujourd’hui la première des conditions requises pour un développement humain. L’homme ne peut passer à côté de ces dimensions au moment même où il en devient le principal initiateur. Nous devenons, dans des proportions inconnues jusqu’à présent, créateurs de nouveaux objets, cause de nouveaux effets collatéraux à nos actions, porteurs de nouvelles représentations et, sûrement, de nouvelles responsabilités. L’anticipation pourrait-elle retrouver son mot à dire dans ce contexte ? L’humanité pourrait-elle poursuivre sa route sans retrouver le moyen d’anticiper ? Savoir repérer au mieux, au plus vite, les impasses de civilisation, parvenir à identifier les risques de changements irréversibles, présenter ces constats dans un vocabulaire accessible à tous, dans une grammaire qui rendra possible une négociation planétaire le cas échéant, tel pourrait être l’objet d’une théorie de l’anticipation adaptée aux réalités du xxie siècle. De façon à parvenir à anticiper, dans des proportions inconnues jusqu’à présent. Pour contribuer à défataliser cet avenir à long terme décidément bien mal embarqué.
[1] Peter Sloterdijk, Essai d’intoxication volontaire, suivi de L’heure du crime et le temps de l’œuvre d’art, p. 271.
Publication : Jean-François Simonin, Mai 2017.
Jusqu’à un passé récent, disons jusqu’à la fin du XXe siècle, il était inutile de chercher à faire des prévisions sur une très longue durée, par exemple à horizon 2050, ou 2100, ou encore 2500. Rien ne l’exigeait vraiment. Si un individu vivant au XVe siècle avait souhaité se représenter le monde de l’an 2000, c’eut été par pure envie de se distraire ; rien à son époque ne rendait nécessaire ce type d’exercice. Le monde était illimité, dans le temps et dans l’espace, c’était une affaire entendue. La nature des activités humaines n’avait aucune incidence sur le devenir de ce monde. L’homme était certes redevable de ses actes devant Dieu ou devant la société, mais pas devant le monde lui-même. Les lois de la nature étaient écrites en langage mathématique, mais cela n’impliquait aucune responsabilité humaine vis-à-vis de l’état du monde.
Ce principe d’une totale disponibilité de l’avenir à l’égard de l’homme est en train de s’estomper ; ce principe devient contre-productif dans le monde d’aujourd’hui, au début du XXIe siècle. Nos choix stratégiques actuels et toutes leurs implications, volontaires et involontaires, influent déjà profondément sur le futur à moyen et long terme, tant au travers des déchets radioactifs, de la création de nouveaux matériaux et de chimères, de la destruction d’espèces endémiques, du changement climatique, des pollutions de diverses natures. Il devient à présent clair que la pensée de court terme, qui est devenue le paradigme temporel commun à l’ensemble de la civilisation occidentale, ne présage rien de bon pour le XXIIe siècle, notamment au regard des enseignements de la mondialisation et de l’anthropocène. Les exigences d’anticipation qui en découlent sont gigantesques, quasi inimaginables.
Anticiper devient, pour la première fois dans l’histoire, une nécessité incontournable. Mais cette nécessité pose un problème de méthode. Car tout se passe comme si la civilisation occidentale ne disposait d’aucun moyen d’anticiper à la hauteur de son pouvoir d’agir.
Car ce qui frappe lorsque l’on fait l’effort d’envisager la trajectoire de l’humanité sur une longue durée, par exemple sur les millénaires passés et les siècles à venir, c’est l’emballement des échelles de grandeur, l’envolée soudaine, depuis environ deux siècles, de plusieurs paramètres de l’expérience humaine qui étaient restés stables durant des millénaires, et se sont brusquement orientés vers des développements exponentiels. Et nous craignons des explosions futures. Des explosions ou des effondrements. Incapables de trier les événements, nous assistons médusés à la déferlante des actualités : nous apprenons le lundi qu’il reste finalement 18 000 têtes nucléaires actives sur la surface du globe ; le mardi qu’il y a bien dissémination des OGM et des nanotechnologies dans les tissus vivants humains ; le mercredi que la biodiversité est entrée dans une phase accélérée de contraction appelée pour l’instant la sixième phase de disparition des espèces ; le jeudi que le climat ne pourra certainement pas se réchauffer de moins de 5 degrés d’ici 2100 ; le vendredi que la première puissance mondiale espionne ses partenaires occidentaux démocrates ; le samedi qu’un nouvel attentat terroriste témoigne de la disparition d’horizon terrestre vivable pour de nombreux candidats kamikazes, et le dimanche, clou du spectacle, que les États occidentaux, souvent de gauche, ont dû puiser dans les fonds publics pour aider massivement diverses associations de malfaiteurs, parmi les plus puissants acteurs mondiaux de l’économie financiarisée, pour mettre leurs richesses à l’abri des turbulences qu’ils ont eux-mêmes suscitées et que la crise de 2008 a mis à jour.
Et dans cette cacophonie nous sommes envahis d’injonctions contradictoires. D’où l’idée du concept BH22. BH22 représente alors une façon d’opérer, momentanément, un tri dans le kaléidoscope de l’avenir. « Consomme toujours davantage, la croissance en dépend » ; « Attention à ton empreinte écologique, ton niveau de consommation est insoutenable au niveau mondial » ; « Participe à l’effort national de compétitivité, sinon notre prospérité, et à terme notre indépendance, en pâtira » ; « As-tu compris à quel point nous avons franchi des seuils irréversibles, qui mettent en péril la poursuite de l’aventure humaine ? » « Aie confiance dans les forces du progrès, elles ont fait leurs preuves depuis longtemps » ; « De toute façon, There Is No Alternative » ; « Les grandes entreprises, les grandes banques, y compris celles qui sont malfaitrices ? Too big to fail ». Avec BH22 il s’agit d’instaurer une sorte de transcendance artificielle imposant la convergence des regards croisés sur le long terme.
Publication : Jean-François Simonin, Mai 2017.